Né le 2 avril 1979 à Harfleur, Frédéric Lecanu est la version tricolore et Jigoro Kano de The Voice. Commentateur, animateur mais surtout metteur en mots, le Français sillonne l’Hexagone depuis 2013 au service de l’équipe de France et d’une haute idée du judo. Né à l’exacte intersection des jougs David Douillet (né en 1969) et Teddy Riner (1989), l’ancien quintuple médaillé national des +100 kg montre que, à force de travail et d’introspection, il existe mille et une manières de rendre à sa discipline un peu de ce qu’il en a lui-même reçu. Il commentera cet été le judo aux JO de Paris et sera l’animateur du Club France olympique. – JudoAKD#006.
Une version en anglais de cet entretien est en ligne ici.
Fred, dans une autre vie, tu as fait partie, avec Matthieu Bataille, Pierre-Alexandre Robin et quelques autres, de cette génération de +100 kg qui a eu une courte fenêtre de tir pour s’exprimer au plus haut niveau entre la décennie David Douillet et les trois décennies Teddy Riner. Avec le recul, ça a été raide ou bénéfique, cette « loterie démographique » ?
Si tu regardes depuis les Jeux de Barcelone, chez les poids lourds le bilan est sans appel. David Douillet titulaire en 1992, 1996 et 2000. Le bilan ? Trois médailles dont deux titres. Porte-drapeau et champion olympique dans la foulée. Une légende… Teddy Riner ? 2008, 2012, 2016, 2021. Quatre médailles individuelles, deux titres. Un titre de champion olympique par équipes mixtes et, lui aussi, porte-drapeau et champion olympique quelques jours plus tard. Et en route pour Paris 2024. Là, il n’y a même plus de mots
Les Jeux d’Athènes en 2004 auront donc été ta/votre seule fenêtre de tir, donc…
Je dirais que ce n’était même pas une fenêtre. C’était une lucarne ! J’en garde un souvenir amer, battu notamment en février de cette année-là au Grand Chelem de Paris au 1er tour par un Egyptien alors inconnu [Islam El Shehaby, futur médaillé mondial et nonuple champion d’Afrique, NDLR] et c’est Matthieu Bataille qui se sélectionne pour les Jeux.
Tu l’as mal vécu ?
Il n’y avait aucun débat là-dessus, en fait. Je pars toujours du principe que lorsqu’on gagne, on ne laisse pas la place au débat. La compétition ? T’es là ou t’es pas là. C’est tout. J’ai eu ma chance. Mes opportunités. Mon expérience. Mon histoire. Tu peux retourner le problème dans tous les sens, et remettre en question tout le contexte… Franchement à quoi ça sert ? Si Matthieu n’était pas là, alors j’aurais fait les Jeux ? Cette question n’a aucun intérêt puisqu’elle ne change pas la réalité. Aurais-je été meilleur avec un autre entraîneur ? Un autre système ? Puisque je ne peux changer la dimension de ce qui est arrivé, pourquoi se torturer ?
Tu vois ça comme une loterie, alors ?
Une loterie peut-être, mais qui serait tenue par qui ? Le mot « hasard » vient de l’arabe qui veut dire « jeu de dés ». Qui jette les dés ? Je ne crois pas qu’il faille trop se faire du mal à ce sujet car il ne faut pas basculer dans l’injustice divine ! Pourquoi eux et pas moi ? Parce qu’ils étaient meilleurs dans ce contexte et puis c’est tout. Se projeter dans un autre contexte n’a aucun sens. Une autre catégorie ? Une autre époque ? Une médaille a plus de valeur s’il y a plus de participants ? Ou pas ? Je me rappelle de longues discussions avec certains de mes copains poids légers, qui me démontraient par A + B que c’était plus dur pour eux. Les régimes, le nombre de concurrents, tout ça. J’ai souvent entendu que les lourds c’était pas pareil. Que ce n’était pas du judo. Que c’était plus facile parce qu’il y avait moins de monde. Bref.
Que répondais-tu à ça ?
J’ai toujours eu le même argument : « Si c’est si facile, pourquoi tu ne combats pas en lourds ? » ? Devant la bêtise de cette question, à court d’argument, mon adversaire de 67 kg du soir me disait : « Bah parce que je peux pas ». Et moi de conclure : « Eh oui, car tu n’as pas le talent de faire plus de 100 kg… » Aparté en passant : la rhétorique, c’est un art. Attaque, contre-attaque, adaptation. Mon système d’attaque a toujours été meilleur à l’oral qu’en kimono [Sourire].
Effectivement…
Pour revenir à ta question, à partir du moment où tu donnes tout, et vraiment tout, il n’y a pas de honte à perdre. C’est dur de perdre, oui, mais c’est formateur. Surtout si tu arrives à t’appuyer sur cette mauvaise expérience pour en faire un entraînement de la vie. À défaut de médailles, on peut quand même porter quelques valeurs. D’ailleurs Socrate l’a dit lui-même : « La chute n’est pas un échec. L’échec c’est de rester là où on est tombé. » Après, je mesure quand même le privilège d’avoir connu toute la fin de carrière de David et tout le début de celle de Teddy. À défaut d’avoir été champion moi-même, j’ai côtoyé deux incroyables légendes que j’ai pu étudier sous tous les angles possibles, techniques, tactiques, physiques mais aussi d’un point de vue de l’impact sociétal, marketing, médiatique… Et, surtout, je reste convaincu d’avoir donné tout ce j’ai pu. Si tout n’est pas mesurable et quantifiable, je reste persuadé d’avoir mis en place, avec le niveau émotionnel, physique et technique qui était le mien à cette période, tout ce qui était possible afin d’être le meilleur. On pourrait refaire cinquante fois l’histoire… Ce qui est fait est fait.
Aucun regret, donc ?
J’ai la conscience tranquille. Travailler ne garantit pas d’être champion, mais ne pas travailler c’est être sûr de ne pas y arriver. J’ai travaillé du mieux que j’ai pu. Le plus dur que j’ai pu. J’en suis convaincu. Et le respect de David, de Teddy, de Matthieu ou de Pierre à mon égard est lié notamment au fait que je n’ai pas triché dans mon engagement personnel, ni dans la sincérité de mon opposition. En tout cas c’est mon ressenti.
Tu ressors de ces années-là avec la sensation d’avoir tout donné ?
L’opposition maximale a au moins un intérêt : celui de mieux se connaitre soi-même et d’en tirer quelques enseignements. Pour mieux rebondir peut-être dans un autre contexte. Et puis ne nous plaignons pas, ce n’est que du sport ! Tout le monde n’a pas cette chance… La chèvre de M. Seguin n’aura jamais eu le luxe de se remettre en question, elle [Sourire]… Et puis tu sais, j’ai encore aujourd’hui des relations tellement fusionnelles avec certains judokas de cette époque que, finalement, le plus important est peut-être là. Avoir encore aujourd’hui Patrice Rognon au téléphone toutes les semaines, aller voir Georges Mathonnet à Briançon dès que possible, partir chaque année dans l’Aveyron chez André Allard, bricoler les week-ends avec Eric Despezelle, voir les petits Stiegelman grandir en même temps que mes enfants… Nous avons partagé des tranches de vie exceptionnelles. Le fait de tout donner, vraiment tout donner, forge des amitiés et des fraternités d’une très grande puissance. Mes amis font partie des plus belles médailles de ma vie.

Ceux qui te connaissent de longue date mais t’auraient perdu de vue sur les dix dernières années ne peuvent qu’être frappés par une chose : ta spectaculaire perte de poids. Que s’est-il passé ?
Après ma carrière sportive – j’aime bien le mot « carrière » , ça fait classe !, alors qu’en vrai je pense qu’on devrait davantage parler d’ « expérience » -, j’ai traversé une période difficile. Une période que connaissent tous les athlètes passés par le haut niveau : la fameuse petite mort.
Comment l’as-tu vécue ?
Comme une perte totale de repères. J’entends parfois qu’on estime que les athlètes vivent dans un cocon, dans un confort… Mouais. Moi la seule chose dont je peux témoigner c’est que, si cocon il y’a eu, il s’appelait INSEP. Et que si confort il y’a eu à un moment, il était avant tout statutaire.
C’est-à-dire ?
C’est-à-dire non pas d’un point de vue administratif, mais d’un point de vue incarnation. C’est confortable d’être un athlète de haut niveau. J’ai aimé cette suite logique de progression. Club, structure fédérale, INSEP. Entraînement, compétition, stage. Ta vie est dure parce que c’est dur, le haut-niveau. C’est dur mais c’est rythmé par des objectifs qui se succèdent. Le déroulé est linéaire, limpide. Simple. Et puis un jour, alors que tu as fait du judo pendant des années, que chaque seconde de ton temps avait un sens, soudain il n’y en a plus. Qui es-tu alors? Quel est ton métier ? C’est là que cette phrase, que je répète souvent encore aujourd’hui, est apparue : « Bon, maintenant, qu’est-ce qui faut qu’on fait ? »
Vraie question…
C’est fou la puissance du mental. Un jour, les gestes que tu as répétés pendant des années, les sacs de stage qui t’attendent en bas de l’escalier, les barres de céréales que tu vas acheter pour ta compète… Tout ça n’a plus de sens. Dans mon cas, tout est soudain devenu trop dur, trop pesant, trop pénible. La répétition, c’est un gage de performance. Mais quand cette quête de performance n’a plus de sens, la répétition devient alors insupportable.
Comment as-tu géré ce cul-de-sac ?
J’ai vécu mon après-carrière comme un combat à mener. Un combat pour protéger ma famille. Un combat pour gagner ma vie. Au début de mon parcours professionnel, je me répétais souvent « je suis sportif, je ne sais rien faire ! » Alors j’ai pris mon courage à deux mains, j’ai lutté contre mes représentations et mes peurs. Tu sais, le mot « monde » possède les mêmes lettres que le mot « démon ». Affronter le monde, c’est affronter ses démons. Nouveau rythme, nouveaux codes, nouvelles relations – la découverte de la notion de collègue, qui m’était jusque-là inconnue… Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d’informations. Trop, parfois.
Par exemple ?
Je pense avoir longtemps souffert d’hyper anxiété. Et j’ai retrouvé, après ma carrière sportive, une addiction que j’avais subie dès l’enfance. Le sport avait canalisé cette maladie qu’on appelle l’obésité. Je l’ai retrouvée, de plein fouet, entre 2007 et 2019. J’ai lutté, j’ai fait des régimes, j’ai essayé de canaliser. Sans résultat. Malgré un parcours de reconversion dont je suis très fier, à 40 ans je pesais 162 kilos. Ce fut ma dernière pesée officielle. Quarante ans de plus, au moins 40 kilos de trop…
…
En décembre 2017, j’ai une alerte. Une crise de tachycardie sans gravité mais qui me secoue. Je pars avec les pompiers en urgence. Dans le camion, la radio et les informations. Les Jeux de Paris 2024 viennent d’être officialisés. Le plus grand évènement de tous les temps arrivera en France. J’avais été speaker du Club France de Rio en 2016. C’est dans ce camion que j’ai décidé que je serai en forme olympique pour cet évènement. C’était mon pari 2024. Je me suis fait opérer d’une sleeve gastrique deux ans plus tard.
Quelles ont été les conséquences sur ton poids ?
Je pesais 160 kg. Je suis aujourd’hui à un poids stabilisé de 110 kilos. Et en pleine forme !

Lorsque tu l’expliques à tes enfants, comment décris-tu ton rôle dans l’écosystème judo aujourd’hui ?
J’ai longtemps cherché à mettre un mot sur un métier, me concernant. Cadre ? Consultant ? Speaker ? Animateur ? Développeur ? J’ai et j’ai eu plusieurs casquettes dans le monde du judo, et parfois j’ai cherché un dénominateur commun à mes interventions. Mon activité professionnelle s’est construite à coups de rencontres et d’opportunités et, malgré mon côté « grande gueule », sur l’observation permanente et l’analyse des systèmes. Pour traverser le monde sans encombre, il faut le comprendre. Et s’adapter. En permanence. Si le judo est la voix de la souplesse et de l’adaptation, on peut dire que j’ai fait du judo toute ma vie. Et pas que sur le tatami.
Comment es-tu venu au judo, d’ailleurs ?
J’ai commencé le judo à l’école avec Guillaume Selle, à Montivilliers en Seine-Maritime. Puis direction le club, toujours à Montivilliers, cette fois avec Gérard Leberquier. Puis le pôle espoir, le pôle France et enfin l’INSEP de 1997 à 2007. J’ai travaillé ensuite dans le secteur de la remise en forme puis de la balnéothérapie, pour revenir dans le judo en 2011 en étant consultant lors des championnats du monde à Paris-Bercy. Depuis, je n’ai plus quitté le judo, sans toutefois fermer la porte à d’autres disciplines, d’autres activités. Bien au contraire.
Quel a été ton moteur, jusqu’ici ?
J’ai voulu, comme on dit « rendre au judo ce qu’il m’avait donné ». Je n’ai cessé d’essayer de le faire et ce sous toutes les formes possibles. J’ai été honoré d’avoir été, pendant quatre ans, le président de l’Association des internationaux de judo. J’ai aussi été très engagé pendant dix ans sur ma mission d’accompagnement des judokas de haut-niveau dans le cadre de leur suivi socio-professionnel. Mes interventions sont multiples et variées, protéiformes. Professeur de sport depuis 2013, responsable des Mercredis de l’équipe de France, élu pendant de longues années au Judo Club de Maisons-Alfort, animateur du traditionnel Kagami Biraki, directeur de l’Itinéraire des champions, chroniqueur avec « Lecanu vs Bundes » sur La chaîne L’Équipe, commentateur olympique sur Eurosport, co-auteur du Judo pour les nuls…
Pfiou !
Les principes du judo sont transversaux. Ils recoupent les besoins de la société et j’ai adoré jouer avec ce Rubik’s Cube qu’est notre discipline pour tourner la bonne facette vers le bon interlocuteur, et inversement. Mais au service de quoi, au final ? C’est mon fils Vitaly qui a su un jour mettre un mot générique sur un concept qui, finalement, correspond tout à fait à mon activité professionnelle. Mon métier, selon lui, c’est « bonheuriste ».

Te voici aujourd’hui identifié comme étant la « voix du judo » français. Comment as-tu construit cette incarnation ? Je me souviens de toi en tribune de presse au Tournoi de Paris 2007 qui murmurait à l’oreille d’Ollivier Bienfait de L’Équipe. Comment s’était faite cette rencontre ?
J’ai commencé à croiser Ollivier après les Jeux de Sydney, en 2000. Il travaillait pour le journal L’Équipe et s’occupait des équipes de France de judo dont il assurait, avec Anouk Corge, le suivi dans les lignes du quotidien. Notre relation débute à la cafétéria de l’INSEP, où il m’invite à déjeuner, pour évoquer ce sujet épineux : y aura-t-il un après David Douillet ?
Quel a été le ton de ce premier échange ?
Je me rappelle d’un repas engagé dans lequel j’ai défendu bec et ongles le potentiel des Français de cette catégorie. On a parlé de Jérôme Dreyfus, déjà vainqueur du Grand Slam de Paris, mais aussi évoqué les plus jeunes dont je certifiais le potentiel. De Matthieu Bataille, qui finira plus tard médaillé mondial et champion d’Europe, en passant par Pierre Robin, lui aussi médaillé mondial et européen par la suite, et enfin en partageant mon propre espoir et ma volonté, à moi aussi, de ramener de précieuses médailles internationales… En gros, à part quelques détails – dans mon histoire c’est moi qui devenais champion des champions, bien sûr – et quelques omissions involontaires (je ne savais pas encore à ce moment-là qu’un certain Teddy Riner viendrait changer la face du monde sportif), j’avais su partager avec Ollivier des principes de judo, des analyses… et pas mal de blagues.
Qu’a donné l’article, une fois publié ?
Il m’a marqué. Déjà parce que, de nos longs moments d’échanges, il ne subsistait plus que quelques lignes – soit le maigre cadeau d’une presse pour le grand public qu’il est difficile de passionner avec nos débats en kimono… Mais, surtout, cet article me marque par la phrase qui me présente : « Fred Lecanu, devant une salade qui en appela une autre ».
Rude !
Déjà que l’article était court, pas sûr qu’il soit flatteur. J’ai rappelé Ollivier, on en a parlé. Une discussion entre d’un côté un journaliste qui découvre une discipline, ses histoires, ses champions et la richesse de cet univers, et de l’autre un judoka qui découvre un métier, ses contraintes, ses limites… Mais aussi sa puissance. Bref, une amitié est née. Cette relation professoniello-affective a même duré puissamment, jusqu’à ce qu’Ollivier prenne d’autres directions que le suivi du judo pour L’Équipe. Il voulait comprendre. Il fallait que j’argumente. Ça a été des échanges passionnés. L’un en quête de savoir. L’autre en quête de partage. Et vice-versa, comme un long et beau randori entre Uke et Tori qui ont échangé les rôles tout au long de ce moment.
Qu’est-il ressorti de ces années de compagnonnage ?
J’ai beaucoup appris avec Ollivier. De quoi parler, et comment l’écrire. Quand se taire, aussi… J’ai été à ses côtés en 2011 aux championnats du monde à Bercy. J’étais consultant presse écrite, web et télé. Juste avant de rencontrer un autre Olivier, Ménard celui-là. Le taulier de L’Équipe du soir qui a été lui aussi très important dans ma vie professionnelle et qui m’a beaucoup apporté. C’était une époque où le scoop n’avait pas encore été remplacé par le buzz. J’ai toujours essayé de partager ma passion du judo. Raconter une histoire, c’est un métier. C’est une activité difficile, multifactorielle et complexe. Et, en fonction du média, les paramètres changent… Ollivier Bienfait ? Il l’a fait avec un grand respect voire une certaine admiration, ainsi qu’un sens du devoir professionnel teinté d’humour et de sensibilité. Bref, un sacré bonhomme…
Si ces expériences fondatrices pouvaient faire gagner du temps à une génération de champions et de journalistes, qu’aurais-tu envie de partager à ces deux entités qui se côtoient souvent mais se connaissent/comprennent finalement bien peu ?
Il y a plein de choses à raconter… Mon premier souvenir comme consultant dans le domaine journalistique remonte à 2004 avec… Harry Roselmack sur Franceinfo. Après avoir obtenu un diplôme Sportcom à l’INSEP, je me retrouve remplaçant de Matthieu Bataille pour les Jeux olympiques à Athènes. Une expérience en radio difficile, confronté à la complexité d’expliquer simplement une séquence terrible pour le judo français et pour ses représentants, la plupart étant des amis directement impactés par cette déroute. On peut dire que, pour une première, ce n’était pas le scénario le plus évident.
Il y a eu bien d’autres expériences, depuis…
En 2007, j’ai commenté pour la première fois sur une chaîne, France Televisions, aux côtés d’Arnaud Roméra. Pour ces championnats d’Europe, cela reste le souvenir d’un incroyable ascenseur émotionnel. Le dernier jour, je commente le titre d’Anne-Sophie Mondière, mon épouse. Quatre minutes plus tard, c’est le titre de Teddy Riner que je décris avec ferveur, partageant au grand public mon admiration pour un gamin de 17 ans qui vient de battre le Russe Tarmelan Tmenov. Le tout en gardant à ce moment-là, enfouie en moi, la détresse d’un constat terrible : place à la jeunesse ; ma carrière sportive à moi, elle est finie.
C’est par la suite que tu commences à intervenir pour le groupe L’Équipe…
En 2011, oui. Je deviens alors consultant pour lequipe.fr, L’Équipe et L’Équipe TV lors des championnats du monde à Paris-Bercy. Une même entité mais trois univers qui ne se ressemblent pas. La presse écrite, le web et la télévision demandent des angles et des temps de travail différents.
Qu’as-tu appris de cette triple approche ?
Ça a été une expérience riche, qui demande de l’adaptation, tant technique que réflexive. D’ailleurs d’une chaîne à l’autre on ne commente pas forcément pareil. Sur La chaîne L’Équipe il faut être très pédagogique. J’y ai créé un personnage, avec (je l’espère !) de bons jeux de mots et de l’humour – au risque d’être parfois caricatural. Sur Eurosport aujourd’hui (ou sur Beinsports par le passé) ce n’est pas le même degré d’analyses. Le public qui regarde est averti et vient chercher plus de technico-tactique et de vision sur les enjeux… Pour chaque miroir, il faut réfléchir !
Ça a aussi été la grande époque des « Lecanu/Bundes »…
… Et l’exercice était encore différent. Des analyses sur tous les sports, en direct sur La chaîne L’Équipe, deux fois par semaine pendant deux ans. Je me rappelle la difficulté de ne pas trop en dire car le temps est contraint, mais surtout pour ne pas perdre le téléspectateur. J’ai appris à structurer mes propos mais surtout à ne pas espérer tout dire. Seulement l’essentiel. Il faut assumer ces silences. Et faire des choix afin que le message soit clair.
Quel rôle aura eu Olivier Ménard dans cette période d’apprentissage ?
J’ai admiré son professionnalisme. Il me donnait les sujets, mais aussi m’interrogeait systématiquement avant l’ émission pour me recadrer ou me conforter dans les choix explicatifs. Il y avait une chute humoristique à trouver à chaque fois, ce qui était très difficile. J’ai eu la chance d’être aidé par mon partenaire Louis Pellissier alias Bundes, avec qui j’allais chercher des frites de piscine pour simuler une fracture, ou un steak avarié dans la cuisine pour faire croire à une blessure au mollet. On a bien rigolé quand même… Matthieu Maes, le chef d’édition, a été lui aussi très important, surtout pour le sketch final qu’on répétait au dernier moment, et qui ne se passait jamais comme prévu pendant le direct.
Malgré tout, cette chouette expérience a dû prendre fin…
Oui c’est Mémé [Olivier Ménard, NDLR] qui, au bout de deux saisons m’annonce, contre toute attente pour moi, qu’il n’y en aura pas de troisième. On commençait à tourner en rond. On rigolait moins. Il m’a expliqué qu’il fallait finir au top. C’est ce qu’on a fait, je pense. Sous la houlette d’un professionnel pour qui j’ai le plus grand respect… Tu sais, plus ça va plus je suis convaincu que la particularité du sport de haut niveau en général, et du judo en particulier, réside dans son côté initiatique. Peu importe le format, qu’il soit écrit, oral, visuel, mensuel, hebdomadaire… Autant tu peux décrypter les aspects historiques, stratégiques ou techniques d’une discipline, autant restera mystérieux à tout jamais l’univers confidentiel d’un vestiaire, la nuit dans son lit la veille d’une finale olympique, la peur d’un premier tour face à une légende de sa discipline… C’est ça la plus grande richesse des athlètes : leur expérience de ce vécu-là.

Tu as d’ailleurs souvent commenté aux côtés d’athlètes français…
Avant ça, j’ai eu la chance de rencontrer Xavier Richefort, un autre homme extraordinaire dans ma vie. Avec lui, j’ai énormément appris. Il était la voix du volley. Il l’a prêtée avec talent au monde du judo. Un ancien volleyeur donc, champion de France avec le PSG. On s’est rencontrés en 2012, pour commenter ensemble le premier tournoi de Paris sur L’Équipe 21. Ça a été un coup de foudre. Là où j’étais angoissé et stressé, Xavier, lui, était nonchalant, à la cool. Il m’a appris toutes les combines : le micro qui ne marche pas, les ordres dans le casque à gérer, les pubs à envoyer… On avait un point commun : aimer les gens, raconter des histoires… Et rigoler. Qu’est-ce que je me suis marré avec lui. Il a rejoint les étoiles en 2022. Il me manque beaucoup… Concernant les athlètes, je me rappelle en effet la richesse d’avoir commenté, pendant quatre ans, le circuit IJF sur La chaîne L’Équipe accompagné des membres de l’équipe de France d’hier et d’aujourd’hui : Loïc Korval, Larbi Benboudaoud, Loïc Pietri, Céline Lebrun, Cyrille Maret, Fanny-Estelle Posvite, Marc Alexandre, Romane Dicko…
Des personnes expérimentées…
J’ai aimé être un lien entre ces deux mondes, à la fois étanches et complémentaires, que sont le sport et le journalisme. J’ai adoré partager avec les sportifs l’univers du commentaire, régi par la notion d’actualité mais aussi par un modèle économique incontournable. De la publicité sur une chaîne gratuite ? On n’a pas le choix. Payer pour accéder aux combats quand ils ne sont pas diffusés sur une chaîne gratuite ? On n’a pas le choix. Partager sa passion dans une activité professionnelle, c’est un privilège. Je commenterai le judo pendant les Jeux olympiques de Paris 2024 sur Eurosport. Je suis comblé.
D’autant que tu es d’une génération qui a dû se lever tôt pendant longtemps pour trouver des infos sur le judo…
Je me rappelle en 1997 lorsque je suis arrivé à l’INSEP. On achetait le journal L’Équipe pour savoir, dans un entrefilet, si Douillet ou Cicot avaient remporté une médaille européenne la veille… À l’époque, les téléphones portables n’existaient pas encore pour nous, et on faisait la queue à la cabine téléphonique pour appeler la famille. Aujourd’hui on peut suivre les combats, avoir des analyses, le retour des médaillés en live… Beaucoup de choses ont évolué, mais ce qui n’a pas changé c’est la place que prennent dans les médias les disciplines récurrentes comme le football, le tennis, le rugby, le cyclisme… Récurrentes et lucratives, car les audiences sont là. Et si les audiences sont là c’est parce que les gens regardent. CQFD.
C’est une logique circulaire…
Tout le danger est là. Le buzz, le spectacle à tout prix… La tentation est grande de tirer sur la ficelle de la facilité. Il faut un juste milieu et ne pas perdre son âme. Quand je commente les caisses à savon, le bucheronnage sportif ou l’Homme le plus fort du monde, j’essaie toujours d’y mettre du sens et de la pédagogie pour le grand public. J’essaie de partager des savoirs, des informations qui peuvent servir, ou à défaut proposer un moment éducativo-amusant. C’est toujours ça de pris… Le nombre de vues, ce n’est pas la garantie absolue d’un travail de qualité. Pendant toutes ces années, mon fil rouge a été d’apprendre et de partager. Partager mon point de vue, partager des informations voire partager quelques rêves. Je pense toujours à l’enfant qui peut tomber sur une image qui pourrait changer sa vie.
Ça a été ton cas ?
J’ai connu ça, oui. C’était avec la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Séoul, projetée dans la petite salle informatique de mon école. J’avais neuf ans et mon intérêt pour le sport a commencé ce jour-là… Mon métier aujourd’hui c’est ça : partager des émotions, des informations, un point de vue. Mais en aucun cas un jugement.

Nous nous sommes croisés quelques fois au festival Sport, littérature et cinéma à l’Institut Lumière à Lyon, animé par son directeur Thierry Frémaux, délégué général du festival de Cannes et lui-même 4e dan. À cette occasion, tu m’as fait part de ton sentiment non d’imposture, mais d’être un peu un intrus dans un milieu qui n’était cette fois pas forcément le tien. Cela m’a rappelé ce que m’avait raconté un jour Gévrise Emane sur sa crise de panique au matin des JO de Londres. J’ai trouvé très intéressant que tu aies l’honnêteté de mettre ces mots-là sur ton malaise. As-tu aujourd’hui compris d’où venait cette inquiétude, que toute ta charpente et ton bagout semblent pourtant démentir ?
Tu n’échappes pas à ton enfance. C’est pour ça que je suis attaché à cette période très importante de la vie. Je pense que si le judo est plus qu’un sport, c’est sûrement là qu’il peut jouer son rôle le plus déterminant. J’aime les enfants et leur monde. Pas pour y retourner ou pour échapper à celui des adultes comme un syndrome de Peter Pan, non. J’aime les enfants et leur monde parce que c’est là que se créent des repères très difficiles à faire évoluer par la suite. Kodomo, dont je te parlerai tout à l’heure, ça veut dire « enfant » en japonais. Un enfant, ça incarne l’espoir.
C’était quoi, ton enfance à toi ?
Il y a en chacun de nous des représentations ancrées depuis toujours. Elles sont issues de notre éducation, notre passé, notre culture, nos croyances… J’ai eu une enfance dans une famille modeste. Ma grand-mère paternelle était femme de ménage. Mes grands-parents, agriculteurs. Une partie de moi a grandi avec une représentation tenace, ancrée, récurrente : « Ça, c’est pas pour nous ». Il est venu peut-être comme ça, ce syndrome de l’imposteur. La sensation de ne pas être à sa place. De ne pas le mériter. Parler de judo sans avoir été champion, c’est pas si évident. Mais de ma mère j’ai hérité d’un cadeau précieux : la notion fondamentale de la valeur du travail.
Qu’entends-tu par-là ?
Dans le premier opus de la saga, Rocky Balboa lui-même comprend la veille du combat qu’il ne peut pas gagner contre Apollo Creed… On ne bouleverse pas comme ça l’échiquier du monde établi. Quelle est sa place dans le monde ? La sienne. Qu’est-ce qu’il reste à Rocky ? Saisir l’opportunité de se battre. C’est, modestement, ce que j’ai fait. Ça, et puis travailler, beaucoup. Pas pour montrer aux autres une quelconque relative réussite ou victoire. Juste pour devenir moi-même.
Un rappeur bien connu disait peu ou prou la même chose, il y a longtemps : « Moi je veux devenir celui que j’aurais dû être... »
Si aujourd’hui je suis directeur de l’Itinéraire des champions, c’est sûrement parce que j’ai eu la chance de croiser les champions de mon itinéraire. C’est notamment avec David Douillet que j’ai compris qu’on pouvait percer son plafond de verre. Au-delà de ses titres, j’ai beaucoup appris grâce à son parcours. Son côté no limit, sa curiosité…
Comment vous êtes-vous rencontrés ?
J’ai rencontré David à Neufchâtel-en-Braye lors d’un stage estival organisé dans son club d’origine. J’avais une quinzaine d’années… Puis j’ai suivi mon chemin, sans perdre de vue son parcours. Je trouvais sa réussite incroyable, inspirante… J’avais son poster sur la porte de ma chambre au pôle France de Rennes. Je le considérais comme un modèle, qui rendait l’inaccessible à sa portée. Puis je l’ai retrouvé à l’INSEP. J’ai été longtemps l’un de ses partenaires. Il m’a ouvert les portes de son monde. Un univers riche, multifactoriel et dans lequel je suis rentré sur la pointe des pieds, en m’excusant d’exister. J’ai été son partenaire pour une publicité pour Coca dont Gérard Jugnot était le réalisateur. J’ai chuté par-dessus une plaque en plexiglass pour un spot pour les débuts d’Internet… David est né en Normandie, comme moi. Il a grandi dans un champ de cresson. Rien ne le prédestinait à la vie qu’il a vécue et qu’il vit encore. Il a voulu être champion ? Il a gagné deux fois les Jeux. Il voulait faire de la politique ? Il a été ministre… David m’a fait comprendre que la plus grande limite est celle qu’on s’inflige. La peur de perdre ne résout rien. Si on y va, on y va. Sinon on n’y va pas !

C’était quoi, tes aspirations de départ, à toi ?
J’ai toujours été curieux. J’ai eu le privilège de traverser beaucoup de mondes différents, de toujours en respecter les codes et les personnes, et de sans cesse chercher à comprendre comment fonctionnent les systèmes. J’ai suivi mon propre chemin, en m’en tenant toujours aux mêmes axes : comprendre les enjeux, anticiper les questionnements, se documenter, chercher les principes qui nous lient les uns aux autres. Et écouter les histoires qui viennent du cœur… Finalement, les leviers de la passion ou de la performance sont les mêmes pour tout le monde. J’ai passé des moments fabuleux avec de grands judokas, mais aussi avec de grandes légendes du sport : Marie-Jo Pérec, Jackson Richardson, Fabien Pelous… Les principes sont les mêmes : doutes, remises en question, abnégation… Et ce cercle n’a eu de cesse de s’étendre à mesure que les commentaires m’ont fait sortir du dojo puis du stade.
Une anecdote ?
Quand j’ai commenté le dixième titre mondial de Teddy Riner avec Thierry Marx, il a fallu réfléchir, mettre cet extraordinaire cuisinier-judoka dans les meilleures conditions pour que ses propos soient en lien avec l’évènement. Trouver les angles cohérents, sortir des sentiers battus. Trouver des principes intelligibles, des recettes transversales… C’est passionnant !
Il n’y a pas vraiment d’imposture, du coup…
Le syndrome de l’imposture réside dans la représentation de ne pas être à sa place. J’ai mis longtemps à comprendre que je pouvais apporter ma personnalité, mes compétences, un savoir construit au fur et à mesure de mes recherches. Et mon histoire, ainsi que celle des autres… J’ai une vie extraordinaire. Je ne l’ai volée à personne. Je me suis battu pour l’avoir et, surtout, ça fait suffisamment de temps que ça dure pour être certain que ce n’est pas qu’un hasard. C’est ma vie. Avec ce que j’ai fait de mieux comme ce que j’ai fait de moins bien. Mais une chose est sûre : il ne faut pas écouter les personnes qui disent que l’on y arrivera jamais. Car ce sont aussi les mêmes qui, une fois que c’est fait, te disent que c’était facile.

En tennis, les tournois du Grand Chelem comptent 128 engagés. À la fin, un(e) seul(e) aura gagné sept matches, ce qui signifie que les 127 autres ont terminé sur une défaite. Si certains en font un levier pour une remise en question salutaire, d’autres, nombreux, cèdent à la tentation, somme toute très humaine, de s’apitoyer sur leur sort, l’arbitrage, la météo… Comme dans tout microcosme, le judo contient aussi son lot de part sombre : jalousies, frustration, aigreur, ressentiment… Est-ce parce que ta voix porte désormais que tu sembles publiquement étanche à ces travers-là ? Quelles barrières t’imposes-tu face à la spirale de la négativité ?
La compétition, c’est effectivement beaucoup d’engagés pour peu d’élus. Au-delà de ce poncif et tous sports confondus, même avec de grands titres, même avec des victoires inoubliables, j’ai rencontré de nombreuses championnes et champions dans le dur après des carrières remarquables. Pas assez de revenus. Pas assez de reconnaissance. Pas assez d’émotions à vivre après tout ça… La liste est longue. Et les remédiations, plus ou moins réalisables. Comment juger le parcours d’un compétiteur ? Et comment peut-il se juger lui-même ? Se remettre en question, se pardonner, ne pas remettre la faute sur l’autre… Elle n’est pas si simple, l’histoire.
Où places-tu le curseur, toi ?
Je ne suis pas sûr qu’ « avoir » c’est « être ». C’est bien pour ça qu’on a deux verbes d’action fondamentaux. Avoir un titre, ce n’est pas forcément être heureux. Avoir une médaille, ce n’est pas la certitude d’être épanoui. Et je pousse le bouchon : est-ce qu’avoir un kimono et une ceinture est la garantie d’être un judoka ?
Vaste sujet…
Aucun système n’est parfait. D’ailleurs je ne suis pas sûr finalement que la perfection existe. Et, comme partout, le monde du judo possède sa part d’obscurité, de démons et d’histoires peu glorieuses… Mais est-ce vraiment là l’essentiel ? À défaut d’être parfait, cherchons à être excellent ! Ou, soyons modestes, un peu alignés avec nous-mêmes, voire heureux si possible. Le tout en gardant bien en tête que le temps nous est compté, lui qui a la faculté de toujours passer…
Quel rapport as-tu au temps qui passe, justement ?
J’aime bien l’idée de pouvoir décomposer le temps en trois catégories. Le temps cyclique, qui revient toujours, comme les saisons qui se succèdent à l’infini. Le temps de l’instant, le moment présent, représenté par le tachiai des sumotoris qui bondissent l’un sur l’autre au signal de l’arbitre. Et enfin le temps linéaire, passé, présent, futur, qui peut être anxiogène car il projette inconsciemment vers la finitude. À l’image de tout combat de judo, la vie se finit par un inéluctable soremade. Dont acte : « Dépêche-toi de vivre, ou dépêche-toi de mourir » parce que la vie, c’est maintenant !
Le haut niveau a un rapport ambivalent au temps. D’un côté il donne l’opportunité de progresser, de l’autre il renvoie aux occasions qui ne se représenteront pas…
Le haut niveau et son perfectionnisme amènent au désagréable constat qu’on finit par la suite à s’attarder davantage sur nos défauts que nos qualités. Si la vie est un magnifique tableau blanc, il y a toujours une petite tache noire au milieu. Et parfois on finit par ne plus voir que ça. Alors que le reste est magnifique mais on ne s’en rend plus compte. Il faut du recul pour analyser la richesse d’un parcours, celle du nombre de personnes rencontrées, du lot d’informations hors normes ingurgitées et des émotions puissantes emmagasinées. Et pour faire le deuil de ses échecs. Car finalement, comme évoqué en amont, s’il y a si peu d’élus, est-ce un échec… ou un enseignement ?
À toi de me dire…
À quoi sert la compétition, finalement ? Eh bien à se connaitre. Vraiment. À affronter ses peurs. À décrypter ses limites. Et, surtout, à développer des stratégies pour s’améliorer et trouver des solutions. Si on s’engage totalement, sincèrement et dans un vrai projet construit, la quête de résultats apporte autant que la médaille elle-même. Et plus encore, je suis persuadé que cette modélisation est exportable à d’autres secteurs, à d’autres personnes… Si le modèle de performance existe, il n’est pas que sportif.
Nous touchons là à l’essence de la discipline…
J’ai adoré décortiquer les principes du judo et en tirer des fondamentaux pour raconter de belles histoires. Le judo c’est plus qu’un sport. C’est une méthode d’amélioration de soi. Et selon son fondateur, Jigoro Kano, une méthode d’amélioration de la société. Un exemple ? La répétition est gage de réussite. Pas de pianiste sans gammes. Pas de judoka sans uchi komi. Et ce principe s’applique aussi à l’inverse. Bousculer quelqu’un qu’on ne connaît pas et sans le faire exprès c’est de la maladresse. Bousculer quelqu’un physiquement (ou psychologiquement) et volontairement pour lui faire mal, c’est de la violence. La répétition de la violence sur la même personne, c’est ce qu’on appelle le harcèlement…
En quoi avoir été compétiteur t’a permis de comprendre cela ?
La compétition et le haut niveau sont des accélérateurs. Ça démultiplie les informations, les émotions, les interactions… Le judo est riche de symboles qui permettent de mieux appréhender la vie. Le monde du haut niveau est redoutable, et l’expérience peut s’avérer douloureuse… mais pas plus que la vie en général, j’imagine. Des décès, des maladies, des injustices : le monde extérieur nous met lui aussi à l’épreuve ! Le combat est avant tout intérieur. Le recul, la méthode enseignée sur un tatami, l’entourage ou toute forme d’aide sont des soutiens pour y parvenir. Une fois que c’est plus clair, à chacun d’essayer de mener au mieux son chemin. Ou sa voie, comme tu veux !
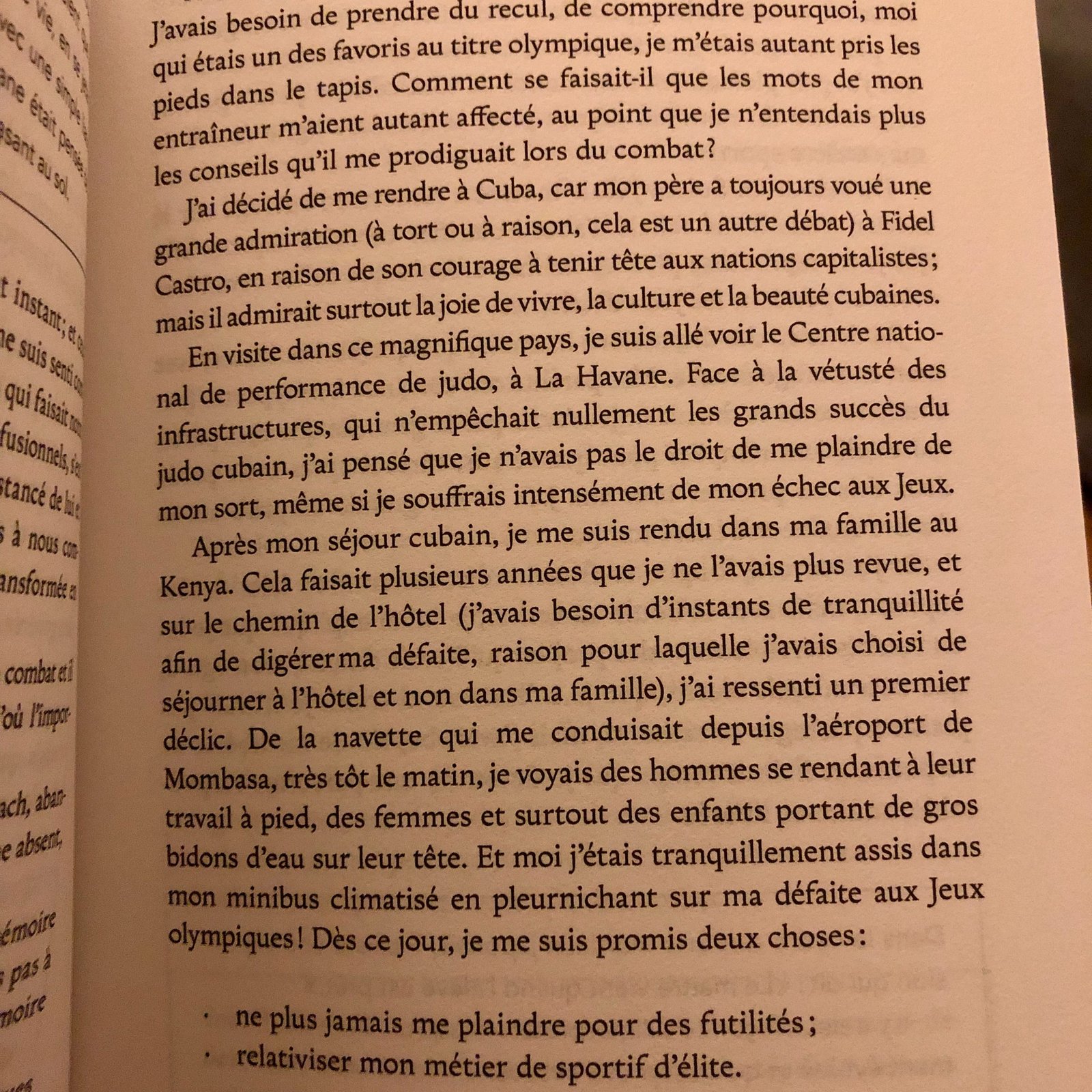
Des tournées que tu animes, le retour qui revient le plus souvent est que ça met des étoiles dans les yeux des enfants. Mais mon petit doigt me dit que ça fait du bien aussi aux champions qui sont conviés. Je me trompe ? L’Allemand Ole Bischof m’a un jour confié (et le Suisse Sergei Aschwanden a dit à peu près la même chose dans une page de sa récente autobiographie, cf. ci-contre) à quel point ces pas de côté ont été l’occasion pour lui de retrouver du sens dans ce qu’il faisait. J’imagine que ça vaut aussi pour certains anciens sur ces évènements…
Athlète, j’adorais participer aux Mercredis de l’équipe de France. J’ai dû en faire une dizaine dont un en Corse où, pour la première fois, nous avions une intervention auprès de personnes en situation de handicap. J’étais à l’époque aux côtés de Matthieu Bataille, Céline Lebrun, Amina Abdellatif, Benjamin Darbelet et Christophe Besnard – je me surprends à me rappeler encore de la sélection alors que ça doit remonter à une vingtaine d’années ! Nous avions été dans leur centre d’hébergement, visité leurs chambres, parlé de judo… Ce qu’Artus a exposé récemment au cinéma avec Un p’tit truc en plus, nous avons eu le privilège de le découvrir il y’a plus de vingt ans grâce aux Mercredis de l’équipe de France et à l’accueil des territoires.
Tu commences à avoir un certain nombre de dates au compteur, quand tu mets tout bout à bout…
Depuis mon arrivée comme cadre à la Fédération, en 2013, et ma nomination en tant que responsable de cette animation, j’ai animé plus de 150 évènements de ce type et ça fera 50 étapes de l’Itinéraire des champions d’ici la fin de l’année. Autant te dire que je connais bien le principe !
Qu’est-ce qui ressort de ces évènements, de ton point de vue d’animateur ?
La magie est incroyable pour les enfants. Pour les jeunes judokas, bien sûr, qui peuvent voir les champions, les toucher, leur parler… Et pour les champions c’est magique aussi. Depuis 2013 et mon premier Mercredi de l’équipe de France à Rouen, aucun ego de star à signaler. Je n’ai eu aucun problème en onze ans. L’humilité a toujours été incontournable de la part de l’ensemble des ambassadeurs et des ambassadrices de notre discipline. Et leur générosité totale dans ce contexte. Mais au-delà de ces interventions dans la famille judo, ce qui marque le plus ce sont les actions sociétales, dans les hôpitaux, les EHPAD, les écoles… Là où, au fil des années, les souvenirs 100% tatami se brouillent un peu, je conserve des souvenirs très précis de moments parfois très durs vécus avec des personnes en grande difficulté.

Par exemple ?
Les images se bousculent dans ma tête… Je revois Matthieu Dafreville et Pierre Robin à Chambéry avec l’association Lemarchal contre la mucoviscidose et cette jeune fille qui témoignait de son combat, les poumons noyés et la voix sifflante. Je revois cet ancien militaire en EHPAD que personne ne venait plus voir, venu en tenue pour honorer la présence des équipes de France, qui nous montrait ses photos. Je revois ce garçon autiste, en crise, calmé par Cathy Arnaud grâce aux pouvoirs magiques cachés dans son cœur. Je revois ce petit garçon, Paul, dont ce fut à Rennes la dernière sortie d’hôpital afin de pouvoir voir les champions, et sa balade main dans la main d’un Marc Alexandre en larmes, submergé par l’émotion après avoir compris que ce tour de tapis était, pour ce garçon en phase terminale, le dernier avant le grand soremade – nous avons reçu à la Fédération l’annonce de son décès quelques jours plus tard…
Comment encaisses-tu ces moments ?
Autant te dire que ça calme. Et que quand tu rentres chez toi le soir, tu serres tes enfants dans tes bras. Fort. Très fort… J’ai vécu plus de dix ans au cœur de fabuleuses histoires : la grande avec ses dates, ses médailles et son sérieux, les petites aussi, avec leurs blagues, leurs moments magiques et ces curieux hasards qui rendent les choses exceptionnelles. Je ne sais pas qui jette les dés du destin mais nous avons vécu une multitude de magnifiques moments dont le scénario n’a pas été écrit par nous.
Par exemple ?
J’ai en mémoire la fin de carrière de Lucie Louette à Amiens. Elle m’a confié, une fois là-bas, qu’elle avait participé exactement au même endroit à son tout premier Mercredi de l’équipe de France. Mais c’était bien plus tôt – quinze ans plus tôt, en fait. Elle était ceinture verte, et c’était elle qui demandait des autographes. La boucle était bouclée… Il y a souvent quelque chose de circulaire dans ces scénarios, d’ailleurs. En 2021, la France a battu les Japonais en finale des premiers Jeux olympiques par équipes là où, 57 ans plus tôt, le Néerlandais Anton Geesink devenait le premier non-Asiatique à devenir champion olympique. C’est bien fait, non ?

Le dimanche 4 février 2024 tu as animé pendant la pause avant les phases finales du Grand Chelem de Paris une rencontre entre des enfants et des champions. En quoi ce moment a-t-il été pour toi bien plus qu’une simple animation ?
Quand on a comme moi eu l’immense privilège de vivre autant d’expériences grâce à une discipline comme le judo, on se doit d’essayer de renvoyer l’ascenseur. J’ai souvent entendu cette phrase : « je veux rendre au judo ce qu’il m’a donné ». C’est ce que j’ai essayé de faire, sous toutes les formes possibles. Au contact des enfants, lors de mes premiers Mercredis de l’équipe de France, j’ai vite fait un constat : il manquait quelque chose. Petit, j’avais été marqué, comme toute une génération, par le très bon travail fait avec Astérix et le Code moral. Imager ces notions par des personnages accessibles, créer des scènes pédagogiques qui parlent aux gens… Soyons clairs : l’idée était géniale ! Alors avec Patrice Rognon, entre autres, nous avons été quelques-uns à travailler sur un code moral Disney afin de redonner vie à un projet qui avait largement fait ses preuves. Ça a été un moment de créativité extraordinaire, dont le but était que Mickey et sa bande puissent désormais incarner les huit maximes posées par Bernard Midan auparavant.
Qu’est-ce que ça a donné ?
Le projet était ambitieux. Trop, peut-être. Une marque a ses exigences. Surtout quand sa puissance est liée à son image. C’est légitime. Le déploiement d’un tel dispositif demandait un contrôle impossible à mettre en œuvre au cœur des territoires. Trop dur. Trop lourd… Un échec que j’ai eu du mal à avaler. De cette expérience est née tout de même une conviction. Si la Fédération devait faire vivre un personnage, elle devait en être le propriétaire.
Comment ça s’est concrétisé ?
J’ai été convoqué très tôt par Stéphane Nomis, devenu président de France Judo, par Sébastien Nolesini, le directeur général et par Sébastien Mansois le directeur technique national, afin de construire ensemble un projet capable de déployer les valeurs du judo : l’Itinéraire des champions. Dans la continuité des Mercredis de l’équipe de France, crées en 1993 et que je dirigeais depuis 2013, place à une tournée qui comporterait 50 étapes sur l’olympiade, avec des championnes et des champions d’hier et d’aujourd’hui. Un spectacle participatif pour les judokas licenciés, mais aussi pour les personnes en situation de handicap, les personnes éloignées de la pratique, les scolaires… Avec mon collègue et ami Laurent Perrin, cela faisait longtemps que l’on travaillait sur ces sujets. Il nous fallait donc une icône récurrente, identifiable, au service des valeurs du judo mais surtout portée par l’espoir de les acquérir… C’est comme ça que Kodomo est né.
C’est quoi Kodomo ?
C’est une histoire dans laquelle j’ai mis toute mon âme d’enfant. Kodomo, c’est le copain imaginaire que je n’ai pas eu étant petit mais qui m’aurait surement aidé, à un moment où j’en avais besoin. Kodomo c’est le remède contre le désespoir. La lumière dans l’obscurité. Le partenaire de la vie qui t’aide à grandir, comme Uke aide Tori à devenir lui-même.
Et Kodomo était donc là lors de cette fameuse pause de février dernier…
Après trois années sur le terrain et quarante étapes au compteur, place effectivement à la dernière animation à proposer lors de la pause du Grand Slam de Paris, avant les dix dernières étapes prévues en 2024. J’ai commencé à animer ces pauses à Bercy en 2014, afin de mettre à l’honneur cinq champions qui venaient de mettre un terme à leur carrière, Thierry Fabre, Benjamin Darbelet, Anne-Sophie Mondière, Matthieu Bataille et Lucie Décosse… Ce dimanche 04 février, c’était la dernière journée de la cinquantième édition du Paris Grand Slam. Fallait pas se planter. Dernière répétition en France avant les Jeux olympiques, avec un plateau exceptionnel de combattants, dont la présence de Teddy, de Romane… L’animation du dimanche devant une salle comble et 15 000 personnes devait être grandiose et elle a demandé beaucoup de travail : convocations, droit à l’image, choix des enfants… C’est comme une compétition. Combien de temps de préparation pour un ippon ? Il ne vaut mieux pas compter.
Comment as-tu vécu ces quelques minutes ?
Ça peut sembler prétentieux, voire incompréhensible mais ce dimanche après-midi-là, j’ai eu l’impression de livrer… une œuvre d’art.
Carrément !
Tous les symboles étaient alignés : la présence de Matthieu Bataille comme arbitre – sûrement le meilleur du monde. Quelle réussite ! Pas étonnant qu’il était plus tactique que moi en tant que combattant ! Je comprends mieux maintenant… Celle de Lucie Décosse – quelle championne ! Avec un balayage improvisé dans le combat contre la petite… Un balayage sorti de nulle part. Du Lucie quoi. Elle est le judo… Sans compter la présence de Cyrille Maret contre un jeune garçon atteint de trisomie… Cyrille va au bout du concept avec un te guruma sifflé par le public… Et hué (gentiment !) par les judokas encore en lice et en phase finale, qui ont regardé la rencontre depuis la salle d’échauffement.
Il y avait effectivement du beau monde…
Iliadis, Kelmendi, Shavdatuashvili… Clarisse qui joue le jeu le lendemain de sa victoire… II y avait aussi Larbi, que je connais depuis si longtemps. Et Kosei Inoue contre qui j’ai combattu deux fois – et perdu deux fois, bon ça va ! La dernière fois que ces deux-là étaient l’un contre l’autre, c’était en finale des Jeux olympiques par équipes, la première de l’Histoire, en 2021 au Japon… C’était un rêve pour moi, mais aussi pour les enfants qui ont eu le privilège de participer. De leur arrivée à la salle au retour au parking, chaque seconde de leur passage restera inoubliable.
C’était quoi l’idée derrière ce format ?
La Fédération internationale souhaitait organiser ce type de rencontre. Elle m’a fait confiance pour les aider à le faire et j’en suis très fier. Nous avons pérennisé avec eux un savoir-faire construit au fil des années grâce aux tournées évènementielles qui ont sillonné les clubs. Le résultat restera gravé dans ma mémoire et dans mon cœur. De par son public incroyable, cette historique année olympique 2024 et l’exceptionnelle coïncidence d’y avoir la cinquantième édition d’un Grand Slam mythique, le moment était déjà grandiose. Et, comme évoqué plus haut, « j’ai voulu rendre au judo ce qu’il m’a donné ». Et Kosei Inoue a même coaché Kodomo… Je répète : Inoue a coaché Kodomo ! Alors que son Japon a été battu par la France en finale de l’épreuve olympique par équipes mixtes à Tokyo, cet immense champion (quelle classe quand même…) joue le jeu, à Paris, au service du message éducatif porté par notre discipline. Inoue a coaché Kodomo… Quel plus grand symbole ? Quel plus grand message ? Quand il n’y a plus rien à dire, le seul mot à formuler c’est « merci ».
Ce moment semble t’avoir ému comme rarement…
Enfant, jamais je n’aurais imaginé vivre un tel moment. J’ai rêvé de titres, j’ai rêvé de médailles… Ce n’était écrit nulle part que mon chemin m’amènerait sur le tapis de la cinquantième édition du Grand Slam… Avec un spectacle à livrer, un message à faire passer et un micro pour le faire. Il n’y a pas de diplôme, pas de formation, pas de carrière clairement définie pour des moments comme ça. Jamais je n’aurais cru que le judo m’aurait permis de vivre autant d’aventures. Et très honnêtement je ne sais pas, avec une enfance compliquée, ce que je serais devenu sans lui… C’est à ça que j’ai pensé en sortant du tapis. Épuisé avec ces trois jours de folie, entre les spectacles à livrer, les commentaires pour La chaîne L’Équipe et les animations des coursives à gérer. Lorsque j’ai imaginé le personnage de Kodomo, jamais je n’aurais pensé possible qu’un jour il puisse atterrir sur le tapis de Bercy. Et que je sois à ses côtés pour le rassurer et le réconforter lorsque combattre était trop difficile pour lui. Peut-être était-ce trop tôt pour lui ? Ou peut-être n’est-il pas fait pour ça ? Tous les enfants ne sont pas faits pour être champion mais le judo, lui, est fait aussi pour leur donner les bases d’une vie équilibrée et pleine de valeurs. Et peut-être même les rendre heureux. En créant Kodomo, j’ai enfin rendu au judo ce qu’il m’avait donné. Et ce truc-là je crois que ça s’appelle l’espoir.
Quelques mois plus tard, en marge de l’Assemblée fédérale à Caen, tu reçois des mains du Président Nomis le Prix du Président 2024. Lors de ton discours, tu dis en parlant de ta cinquième place aux Europe 2002 que « chaque médaille a son revers et qu’il est beau, le revers de la médaille« . Que veux-tu dire par là ?
Même si j’ai participé à un nombre incalculable de remises en tant qu’animateur, je n’avais jamais été honoré officiellement personnellement. J’ai toujours été troublé par l’émotion forte provoquée par la remise d’un prix, qui peut sembler être un moment dérisoire. Je m’étais toujours demandé comment je réagirais, si un jour on me remettait une telle distinction. Ce jour-là, je ne savais pas que j’allais être honoré. Mon discours était improvisé.
Alors, comment as-tu réagi ?
Lors de sa remise, la sincérité de Stéphane m’a beaucoup touché. La (très !) longue ovation des acteurs du judo français m’a bouleversé. C’était à la fois une performance professionnelle et personnelle qui étaient saluées. Forcément, l’ensemble de mon parcours est repassé dans ma tête, à toute vitesse. Il m’a alors paru évident de faire un clin d’œil à mon plus grand échec sportif personnel mais surtout à mon parcours depuis celui-ci.
Cette cinquième place européenne, donc…
Ce jour-là, en 2002, à Maribor en Slovénie, j’ai quatre combats à faire pour être médaillé européen. Le tirage est loin d’être facile, je prends au premier tour le redoutable Néerlandais Dennis van der Geest, champion d’Europe en titre. Ce premier combat est âpre, engagé jusqu’à la dernière seconde – mais soutenu par mon coach… David Douillet, qui était devenu pendant un court instant entraîneur. Avec un petit yuko d’avance, je passe ce tour et me retrouve face à Ernesto Perez, l’Espagnol vice-champion olympique, battu par David à Atlanta. Un uchi mata en une dizaine de secondes et me voici en demi-finale. La suite ? Le drame. Battu par Pedro Soares, très solide et élégant Portugais, aujourd’hui entraîneur de son équipe nationale. En fin de combat, à court de souffle, je glisse mon pouce dans ma ceinture pour accélérer le relâchement d’un nœud qui était en train de se défaire. Je sentais la pression du tissu sur mes hanches moins importante, je voulais provoquer une pause qui serait arrivée naturellement à la séquence suivante. À défaut de gagner une respiration, je perds le combat par shido, sanctionné pour avoir intentionnellement voulu défaire ma tenue. Les portes de la finale se ferment la dessus. Je ne serai définitivement jamais un tacticien.
Il te restait encore la place de trois…
En place de troisième, remonté comme un coucou, je mène jusqu’à quinze secondes de la fin face au Polonais Janusz Wojnarowicz. La médaille est à portée de main, presque autour de mon cou. Il appelle le médecin, se plaint de son genou. Il est cuit. Et puis, dans un dernier espoir, il se jette sur moi en ko soto gari, qu’il faisait très bien. Je recule et cherche la rotation, mais la masse du Polonais de 180 kg est trop lourde pour moi. Je bascule. Ippon pour lui.
Ouch.
J’ai été incapable de gérer cette poignée de secondes. Ça m’a par la suite longtemps réveillé la nuit. Je ne serai jamais médaillé européen.
Qu’as-tu appris de cette douloureuse expérience ?
Qu’on se construit sur ses échecs. C’est beau mais finalement on n’a pas le choix. C’est trop dur de se détester. J’ai mis longtemps à me pardonner. On ne se construit pas qu’avec les défaites. Il faut aussi voir la réalité des choses. Je me rappelle d’un championnat d’Europe par équipes avec la France. J’étais dans une forme exceptionnelle. Dans la zone comme on dit, ce moment où tous les curseurs sont au top et où l’on marche sur l’eau. On prend les Russes en demies. Je fais match nul avec Mikhailin sur qui j’avais toujours perdu. J’ai vu mon top niveau. J’ai aussi compris à ce moment-là que je ne le battrai jamais. Que je ne serai jamais champion du monde ou olympique… Pourquoi cette cinquième place si douloureuse ressort au moment où on me remet ce prix à l’Assemblée générale 2024 ? Sûrement parce qu’on ne peut apprécier pleinement sa réussite du moment sans oublier ses pires moments du passé et, heureusement les enseignements qui vont avec.
Peux-tu développer ?
L’échec, c’est l’erreur doublée d’un sentiment de défaite. Certaines erreurs peuvent être rectifiées sans trop de difficultés. Mais les échecs nous terrassent. Devenir champion est une quête. Nous y jouons une part de nous-mêmes, liée à ce que Freud appelait l’idéal du moi. C’est notre valeur même qui est remise en question. Echouer à devenir ce que l’on considère de meilleur, c’est le constat qu’on devient ce qu’il y a de pire… Tout cela m’a accablé un temps puis, heureusement, obligé à prendre du recul. Ne pas confondre notre personne avec notre ratage, mais l’observer plutôt comme un fait à analyser. Saisir l’occasion d’en faire un apprentissage.
Et donc, cette métaphore de la médaille et de son revers ?
La médaille brille. Avec une face tournée vers les autres. Mais la médaille est aussi un miroir. Avec un côté obscur, personnel. Et si le trésor de cette quête n’en était pas que le but mais aussi le chemin ? Ce n’est pas pour rien que le revers est caché. Il est placé directement sur son cœur. À chacun d’en tirer les enseignements pour continuer à s’améliorer afin de pouvoir trouver autrement son épanouissement. Je n’ai pas eu de médaille pour mon travail. Mais j’ai eu un prix, bien plus tard. Ce soir-là j’ai eu surtout beaucoup d’applaudissements, de sympathie, de témoignages de respect… Il est beau le revers de la médaille, car il m’a emmené et surtout permis de comprendre comment aller jusque-là. Ça valait le coup d’attendre.

Tu dis que pour réussir autant d’Itinéraires des champions, il a fallu être le champion de son propre itinéraire. Ça ressemble beaucoup à ce que mon père appelle « le métamorphisme de contact », à savoir que l’on devient ce que l’on côtoie. Il y a un peu de ça dans ta formule ?
Bon allons-y pour les développements scientifiques, si je te suis dans le raisonnement. Un protolithe c’est un caillou tout simple, pas abouti. Le métamorphisme, c’est sa mutation, sa transformation, son aboutissement « dans un régime de contraintes au cours d’un temps long. Cette transformation se traduit par une modification de la texture, de l’assemblage minéralogique de la composition chimique de la roche pour en donner un produit fini. » En fait elle est pas mal, la métaphore de ton père !
Merci pour lui [Sourire] !
Ça sous-entendrait qu’au contact des champions j’aurais réussi a comprendre leurs modèles de performance sportive pour en faire un modèle de performance de vie. Eh bien c’est loin d’être bête, figure-toi. C’est même complètement ça, en fait… J’y ajouterais juste un équilibre entre deux notions.
Lesquelles ?
Premièrement l’opposition entre raison et passion – un classique en philosophie. L’homme, par définition, serait un animal raisonnable. Le judo et ses principes m’aident à me tenir debout. Droit. Entre trop et pas assez. L’Itinéraire des champions, par son volume de dates, sa complexité et son exigence, m’a obligé à combattre les mauvaises passions et garder les meilleures. Tout en devenant raisonnable. En tout cas le plus raisonnable possible.
Quid de la seconde notion que tu évoquais ?
Pour ça il faut aller jeter un coup d’œil du côté de Rousseau (pas Didier, l’autre !). Pour Rousseau, deux passions sont naturelles, antérieures à la raison et bénéfiques : l’amour de soi, « qui porte tout animal à veiller à sa propre conservation » et la pitié qui « nous inspire une répugnance naturelle à voir périr ou souffrir tout être sensible et principalement nos semblables ». Ce sont les passions perverties par la raison délirante que Rousseau condamne. Ainsi, l’amour-propre, à ne pas confondre avec l’amour de soi, nous pousse à nous comparer aux autres et à vouloir les dominer. Je pense que c’est l’Itinéraire des champions qui m’a fait passer de la phase de l’amour-propre à celle de l’amour de soi.
Il semble y a avoir là tout un cheminement…
J’ai beaucoup travaillé sur ces principes pour mieux comprendre les autres… et mieux me comprendre moi-même. L’Itinéraire des champions, c’est aussi le passage initiatique de l’envie au besoin. Le besoin peut se traduire par la nécessité de trouver une satisfaction afin de préserver l’équilibre à la fois physiologique, physique, psychologique et mental de notre être. C’est le Shin Gi Tai des Japonais. Là où le besoin est motivé par la pulsion de vie, l’envie est animée par la pulsion de destruction.
C’est-à-dire ?
C’est la colère qui nous envahit et qui nous fait vouloir posséder et détruire ce qu’un autre a en sa possession. Nous pensons que ce que l’autre possède lui procure de la satisfaction, c’est pourquoi nous voulons le posséder à notre tour. Me concernant, je n’envie pas la médaille des championnes et des champions que je côtoie depuis si longtemps. Mais j’ai besoin de la partager. À travers des évènements, des commentaires, des histoires… Pour celles et ceux qui ont besoin de les écouter. Pour partager des informations, des émotions, des outils de performances… Ou pour faire du bien, tout simplement. Même si c’est ma démarche, je n’ai pas la prétention d’être devenu sage. Plus équilibré, peut-être, et ce serait déjà pas mal… Rends-toi compte : avoir trouvé mon équilibre grâce à une discipline qui a pour but de créer le déséquilibre ? Le pied de nez serait total.

Si le Fred de 2024 pouvait donner des conseils à celui de 1989 qui enfilait sa première ceinture blanche au regard de tout ce qui l’attend, que lui dirait-il ?
Il lui dirait : « Fais confiance à la pratique d’une discipline qui va changer ta vie, et te la changer en mieux. Pour commencer, donne-toi toutes les chances de devenir champion, puisque c’est ça qui t’anime, afin de n’avoir aucun regret. Ouvre grand tes yeux, tes oreilles et ton cœur. Fais chaque chose dans le but de devenir un petit peu meilleur. Intègre les principes d’évolution qui te serviront pour ta vie d’homme. A défaut de devenir le meilleur, tu seras unique… Écoute bien, parce que le judo est plein de symboles qui te permettront d’avancer dans ta vie. Analyse-les. »
Tu penses à des situations précises ?
Au sol, par exemple. Je dirais à ce jeune Fred de 1989 que « on va t’apprendre que pour gagner il faut tenir l’autre sur le dos. Mais ce qu’on te dira moins, c’est que le plus dur mais le plus profitable dans le temps consiste à sortir de l’immobilisation. C’est un immense effort de se dégager de cette force qui t’écrase. De se décaler et de reprendre l’initiative. Mais c’est à ce prix seulement que tu pourras te relever. Te re-verticaliser. Tenir debout pour repartir sur ta voie… Ne te pose pas trop de questions, en fait. Ne cherche pas à tout prix à être aimé des autres. Apprends déjà à t’aimer toi-même… Tu es un peu perdu aujourd’hui ? Tu as 11 ans et tu fais 100 kg ? Alors sors de ton immobilisation et fonce vers ton destin. Rien n’est arrêté. Regarde dans le film Harry Potter… La nature d’Harry est d’être un Serpentard, et puis il décide de devenir un Griffondor. Si sa condition n’est pas définitive, c’est que la tienne ne l’est pas non plus. Tu es gros ? Alors deviens un poids lourd ! »
Ça se tient…
Sauf un détail : il n’y avait pas Harry Potter en 1989… [Sourire]
Bien vu !
Du coup je lui dirais aussi : « Tu verras, l’idée du duo Uke/Tori est formidable. Le but est de se faire progresser l’un/l’autre dans l’entraide et la prospérité mutuelle. Car tout ça fonctionne aussi dans la vraie vie. Car un jour, qui sait, tu rencontreras une formidable et exceptionnelle personne. Vous partagerez à deux un randori de vie dans lequel tout ne sera pas facile. Et puis tu réaliseras que sans elle tu ne seras rien. Tu verras qu’à un moment de ton existence, tu te tourneras derrière toi et tu constateras qu’elle est à tes côtés depuis longtemps, si longtemps… Tu mesureras que la vie sans elle n’aurait eu, n’a et n’aura aucun sens… N’oublie pas de le lui dire quand tu le pourras. » Le message est passé. Merci pour tout Anne-So. Je t’aime d’un amour immarcescible. – Propos recueillis par Anthony Diao, printemps-été 2024. Photo d’ouverture ©Laëtitia Cabanne.
Une version en anglais de cet entretien est en ligne ici.
– Bonus : l’entretien qui déclencha le présent entretien –
Lire aussi, en français :
- JudoAKD#001 – Loïc Pietri – Le franc Français
- JudoAKD#002 – Emmanuelle Payet – Cette île en elle
- JudoAKD#003 – Laure-Cathy Valente – Lyon, troisième génération
- JudoAKD#004 – Retour à Celje
- JudoAKD#005 – Kevin Cao – La parole aux silences
- JudoAKD#007 – Shin Gi Tai – (Hier) AUJOURD’HUI (Demain)
- JudoAKD#008 – Annett Böhm – De l’autre côté
- JudoAKD#009 – Abderahmane Diao – Infinité de destins
- JudoAKD#010 – Paco Lozano – Le combat dans l’oeil
- JudoAKD#011 – Hans Van Essen – Monsieur JudoInside
- JudoAKD#012 – Judo aux JO 2024 – J1/8
- JudoAKD#013 – Judo aux JO 2024 – J2/8
- JudoAKD#014 – Judo aux JO 2024 – J3/8
- JudoAKD#015 – Judo aux JO 2024 – J4/8
- JudoAKD#016 – Judo aux JO 2024 – J5/8
- JudoAKD#017 – Judo aux JO 2024 – J6/8
- JudoAKD#018 – Judo aux JO 2024 – J7/8
- JudoAKD#019 – Judo aux JO 2024 – J8/8
- JudoAKD#020 – Après les Paralympiques – Post-scriptum.
- JudoAKD#021 – Benjamin Axus – Toujours vif
- JudoAKD#022 – Romain Valadier-Picard – La prochaine fois, le feu
- JudoAKD#023 – Andreea Chitu – Nos meilleures années
- JudoAKD#024 – Malin Wilson – Venir. Voir. Vaincre.
- JudoAKD#025 – Antoine Valois-Fortier – La constance du jardinier
- JudoAKD#026 – Amandine Buchard – Le statut et la liberté
- JudoAKD#027 – Norbert Littkopf (1944-2024), par Annett Boehm
- JudoAKD#028 – Raffaele Toniolo – Bardonecchia, en famille
- JudoAKD#029 – Riner, Krpalek, Tasoev – La guerre des trois n’a pas eu lieu
- JudoAKD#030 – Christa Deguchi et Kyle Reyes – Un trait d’union en rouge et blanc
- JudoAKD#031 – Jimmy Pedro – Il était une foi en l’Amérique
- JudoAKD#032 – Christophe Massina – Vingt années ont passé
- JudoAKD#033 – Teddy Riner/Valentin Houinato – Deux dojos, deux ambiances
- JudoAKD#034 – Anne-Fatoumata M’Baïro – Le temps d’une vie entière
- JudoAKD#035 – Nigel Donohue – « Ton temps est ton bien le plus précieux »
- JudoAKD#036 – Ahcène Goudjil – Au commencement était l’enseignement
- JudoAKD#037 – Toma Nikiforov – Les années Kalashnikiforov
JudoAKD – Instagram – X (Twitter).



